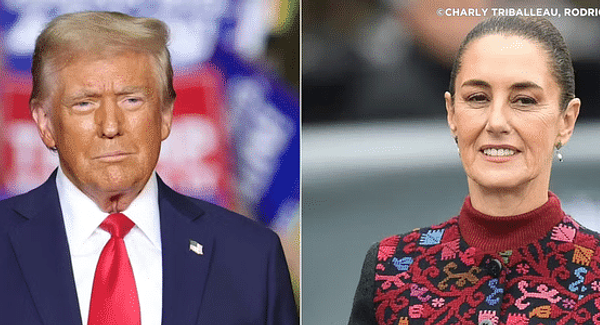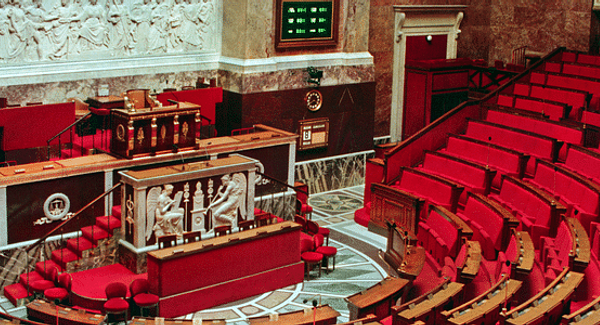The Conversation : « La responsabilité sociale des entreprises, un outil pour court-circuiter les syndicats ? »
Publié par Université Savoie Mont Blanc, le 11 septembre 2025 220
La responsabilité sociale des entreprises est souvent perçue comme un levier pour améliorer les relations de travail, en renforçant le lien direct entre employeurs et salariés. Mais ce dialogue direct ne conduit-il pas à contourner les représentants du personnel et/ou les syndicats, allant jusqu’à affaiblir la place de ces derniers ?
Depuis 2001, la Commission européenne définit la responsabilité sociale des entreprises (RSE) comme un engagement volontaire allant au-delà des obligations légales, destiné à répondre aux attentes des parties prenantes : actionnaires, clients, fournisseurs, ONG, territoires… Mais parmi tous ces acteurs, un consensus émerge pour estimer que les salariés restent la partie prenante la plus centrale, car ils conditionnent directement la crédibilité et l’efficacité des stratégies RSE.
Pour répondre à leurs attentes, les entreprises investissent dans des actions très concrètes : rémunération, santé et sécurité, conditions de travail, qualité des relations professionnelles, négociation collective, respect de la dignité au travail, lutte contre les discriminations, communication interne ou encore droits des salariés. Loin d’une logique descendante et unidirectionnelle de la RSE, ces pratiques encouragent une participation plus active et directe des employés, en les tenant informés, en les consultant et en les impliquant dans la vie de l’entreprise… et capables dès lors de co-construire la RSE.
Deux voies pour dialoguer avec les salariés
Dans l’entreprise, le dialogue avec les salariés prend aujourd’hui deux formes. La première, la plus ancienne, passe par leurs représentants élus, un héritage de la révolution industrielle et de l’essor du syndicalisme. La seconde, plus récente, qui se renforce dans le cadre de la RSE, privilégie une relation directe, à base d’enquêtes internes, de boîtes à idées, de groupes de discussion ou encore de réunions avec la direction.
Avec le numérique, ce dialogue s’est élargi grâce aux intranets, messageries et plates-formes collaboratives. Ces dispositifs participatifs traduisent une volonté d’associer davantage les salariés aux décisions qui concernent leur quotidien de travail.
Multiples frictions
Face à la montée des stratégies de responsabilité sociale des entreprises (RSE), les syndicats adoptent une attitude prudente, parfois méfiante. Rappelons le contexte : les interactions directes entre employeurs et salariés progressent alors même que les syndicats voient leur influence reculer. Les représentants des salariés sont de plus en plus affaiblis et, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le taux de syndicalisation diminue dans bon nombre de pays.
Toutefois, leur légitimité demeure forte sur les enjeux sociaux et salariaux, mais beaucoup moins sur les questions environnementales, pourtant centrales dans la RSE. Cette dernière couvre un éventail très large de sujets, qui, traditionnellement, ne sont pas traités par les syndicats. En outre, les syndicats défendent avant tout les salariés au niveau local ou national, quand la RSE invite à élargir la focale aux chaînes mondialisées de fournisseurs ou de sous-traitants.
Les représentants du personnel court-circuités
Un dernier point de friction réside dans le fait que les organisations syndicales redoutent que les engagements volontaires de la RSE ne viennent se substituer aux réglementations contraignantes de l’État. Certaines refusent aussi d’être considérées comme une partie prenante « parmi d’autres », au même niveau que les consommateurs ou les ONG.
Dans ce contexte, la montée en puissance de la RSE pose une question centrale : les représentants du personnel risquent-ils d’être court-circuités ? Face à une RSE qui encourage des échanges plus directs entre employeurs et salariés, les entreprises pourraient être tentées de privilégier ces canaux participatifs, au détriment des instances représentatives traditionnelles. Derrière cette évolution se joue un enjeu démocratique : la place des représentants élus dans le dialogue social est-elle appelée à se réduire ?
Ce que montrent les données
Pour répondre à cette question, une étude basée sur plus de 1 000 entreprises et de leurs représentants du personnel a été menée au Luxembourg. La législation luxembourgeoise impose la représentation des salariés dans les entreprises, et les syndicats continuent d’exercer une influence sur la prise de décision. Les syndicats représentatifs disposent, entre autres, du droit de conclure des conventions collectives à différents niveaux, y compris au niveau de l’entreprise.
Dans les entreprises de plus de 15 salariés, des élections doivent être organisées tous les cinq ans pour désigner une délégation du personnel, ces élections récurrentes constituant également un moyen pour les syndicats d’affirmer leur présence. Selon l’article L. 414-2 du Code du travail, la mission des représentants du personnel est de « sauvegarder et défendre les intérêts des salariés ». Les employeurs ont l’obligation d’informer les représentants du personnel sur divers sujets, notamment les stratégies de l’entreprise, sa situation économique et son évolution prévisible. Les pratiques de dialogue social varient fortement selon les secteurs et les entreprises, comme le reflète le taux de couverture des conventions collectives.
Les résultats montrent que l’adoption d’une stratégie RSE transforme en profondeur les relations sociales. Les entreprises engagées dans la RSE multiplient les échanges directs avec leurs salariés : réunions plus fréquentes, espaces d’expression facilités, possibilité accrue de poser des questions. Dans le même temps, elles entretiennent aussi davantage de contacts avec les représentants du personnel… mais privilégient aussi la consultation plutôt que la négociation.
Un dialogue social à deux vitesses ?
En clair, la RSE favorise à la fois l’intensification des relations directes avec les salariés et certaines formes d’échanges avec leurs représentants, sans pour autant que les unes remplacent les autres. Toutefois, si les relations directes et indirectes ne sont pas en concurrence, la nature de ces interactions diverge et la différence est de taille : participatives avec les salariés, largement unidirectionnelles avec leurs représentants. Ce « dialogue social à deux vitesses » pourrait donc, à terme, affaiblir le rôle des syndicats, relégués en dehors d’une communication bilatérale et de solutions véritablement négociées.
Ce risque est d’autant plus grand au sein des PME, où la représentation syndicale est relativement moins nombreuse que dans les plus grandes entreprises. Ce type d’entreprises présente également des ressources limitées qui peuvent les conduire à prioriser un type de relation (ici, direct avec leurs salariés). Des effets sectoriels sont également à noter : les entreprises industrielles ont moins de contacts avec les syndicats mais recherchent davantage de solutions négociées que celles du commerce.
Comment expliquer ce dialogue social à deux vitesses ? Doit-on voir ici la marque du scepticisme des représentants du personnel et des syndicats à l’égard de la RSE et une volonté de rester dans leur zone de confort ? En clair, une volonté de ne pas prendre part à des négociations sur des sujets hors de leur périmètre traditionnel. Au contraire, ce résultat est-il l’expression de l’opportunisme des employeurs qui chercheraient volontairement à réduire la voix des syndicats et limiter leurs rôles dans de nouveaux champs stratégiques, notamment environnementaux. Enfin, nous pouvons aussi faire l’hypothèse que les salariés ont moins confiance dans leurs représentants et préfèrent une communication plus directe, sans intermédiaire.